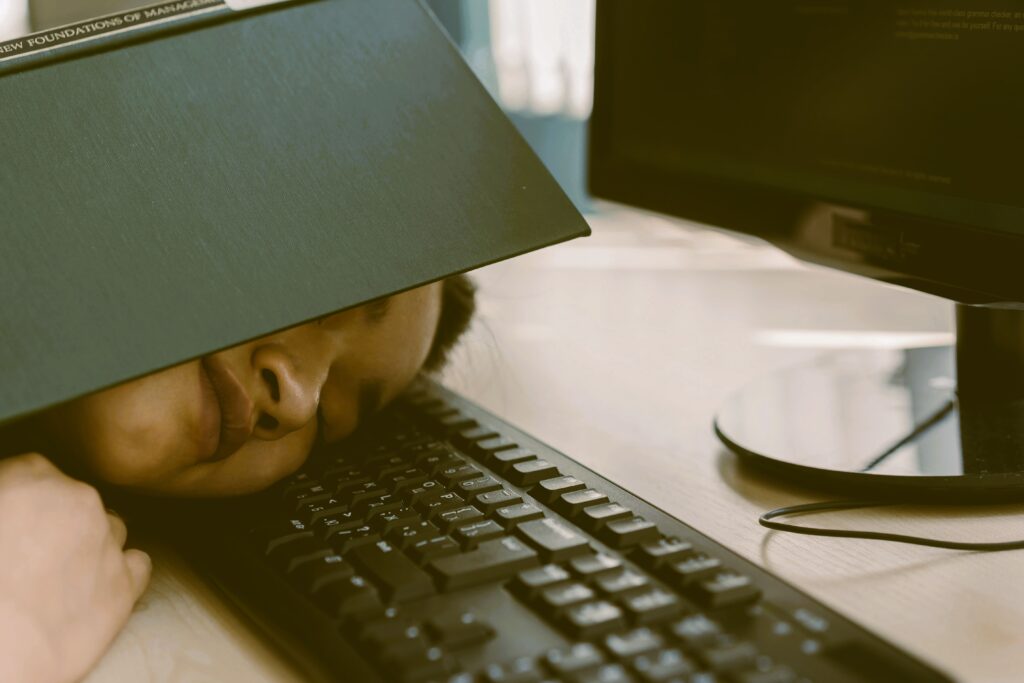Des élèves épuisés…
Au mois de mai, la Cour des Comptes a publié un rapport sur l’état de l’enseignement primaire en France. Sans surprise, on y lit que la situation de nos enfants n’est pas bonne.
L’école n’est pas seule en cause, qui représente 32 % de leur temps. C’est moins qu’au début du XXe siècle : l’école d’alors accordait bien plus d’heures d’études à un nombre d’élèves bien moins conséquent. Les temps ont changé : du fait de l’activité et de la mobilité des parents, les journées des jeunes se sont considérablement allongées. Dès la troisième semaine de septembre, parents et enfants sont désynchronisés, la société est épuisée : c’est systémique… et on le sait.
… une nouvelle convention pour tout changer ?
Le président Macron a semblé vouloir y remédier en confiant au Conseil Économique Social et Environnemental, le CESE, l’organisation d’une Convention citoyenne sur les temps de l’enfant, la troisième du genre après les conventions sur le climat et sur la fin de vie. Sans surprise, les enfants de six à douze ans d’ores et déjà consultés se disent épuisés, en particulier ceux des milieux ruraux qui subissent de longs déplacements… et il est à parier que le panel d’adolescents de douze à dix-sept ans consultés en octobre confirmeront…
En novembre, cent quarante citoyens panélisés et tirés au sort vont donc remettre leurs propositions, après débats, échanges et rencontres avec des experts, une nouvelle expérience démocratique qui, selon toute vraisemblance, ne fera pas avancer le débat. Voyons pourquoi, avec ces paradoxes que le législateur aura sans doute bien du mal à surmonter.
1 – Avec la rentrée de septembre, la société toute entière se resynchronise autour de l’école et croit ainsi se caler sur ce « temps des enfants » mais rien n’est plus faux
Elle peine au contraire à leur accorder le temps nécessaire aux apprentissages, aux loisirs, au temps libre ou au sommeil. Des intérêts économiques prennent le pas sur les vrais besoins biologiques, étudiés depuis longtemps et connus pour se modifier au cours de la vie.
Les adolescents, par exemple, connaissent un décalage de phase et ont besoin de se coucher plus tard et de dormir beaucoup. Les moments les plus propices à l’apprentissage ne sont pas tôt le matin, a fortiori pour eux : les horaires imposés par le monde du travail sont générateurs de fatigue, de stress, parfois d’échec. Selon le Conseil Scientifique de l’Education nationale, décaler d’une heure la prise de cours modifierait favorablement le sommeil, agirait sur la santé mentale et améliorerait substantiellement les performances scolaires…
2 – On sait beaucoup mieux qu’avant quels rythmes nous conviennent mais en dépit de nombreux programmes de recherches menés par d’éminents spécialistes, on les respecte beaucoup moins qu’avant
On répète à l’envi que les enfants doivent s’ennuyer… mais est-ce audible pour des parents qui, dans un contexte économique anxiogène, investissent beaucoup la scolarité et la réussite de leur enfant ?
De même, l’école rationalise le temps en empilant des heures, dans une perspective utilitaire souvent sans objectif concret ni épaisseur : telle heure est dévolue à tel apprentissage, quasiment coûte que coûte. Or, notre perception naturelle du temps n’est pas calée ainsi… Il n’est qu’à jeter un coup d’œil sur l’emploi du temps d’un collégien pour mesurer la plasticité cérébrale dont il doit faire preuve au cours d’une matinée…
Quant aux journées d’école des primaires, si elles se sont écourtées, les parents n’ont pas changé leurs horaires si bien que les enfants coincés dans leur établissement n’ont pas gagné en temps de repos ni en temps de qualité, du fait d’activités périscolaires souvent au rabais.
3 – On a besoin d’être synchronisé aux cycles biologiques… et pourtant la société est calée sur la semaine, une construction sans réalité naturelle
Entre la journée et le mois, nous avons mis en place cette temporalité artificielle qui impose cinq jours d’activités structurées, abandonnées les deux jours suivants. Ce rythme est absolument délétère pour l’organisme qui a besoin de régularité… et pour la plasticité cérébrale des enfants qui n’aime pas les masses temporelles : tout puis rien.
Cette organisation hebdomadaire met en outre en évidence le fait que le temps à un genre : ce sont souvent les mères qui gèrent les emplois du temps, aident aux devoirs et portent la charge mentale. Le temps des femmes est un impensé incontournable dès lors qu’on souhaite alléger le rythme des enfants : pourra-t-on y parvenir sans creuser les inégalités, en particulier dans les milieux les plus défavorisés ?
4 – On trouve que le temps scolaire est employé à de multiples activités inutiles, au détriment des fondamentaux… et on laisse nos enfants jouer ou scroller sur des écrans
L’école se charge désormais de missions pléthoriques : laïcité, égalité fille/garçons, développement durable complètent les fondamentaux… ou plutôt les grignotent, ce dont beaucoup de parents s’émeuvent. Leur journée, comme celle de leurs enfants, est d’ailleurs rationalisée au possible : comment reprocher aux uns et aux autres de céder au divertissement facile qu’offrent les GAFAM, ces prédateurs de temps ? Si la question des écrans se pose depuis les années 2000, Zuckerberg et consorts ont créé une tranche d’activité nouvelle qui représente autour de trois heures selon les âges et jusqu’à cinq heures pour les ados. Leurs capacités d’attention et de concentration altérées par un rythme sommeil/veille déjà dérégulé s’effritent… ce à quoi tous les CESE ne pourront pas grand-chose, sauf peut-être à interdire le portable aux moins de seize ans, comme en Australie… et encore.
5 – La technologie est censée nous faire gagner du temps… or pour le moment, elle nous faire perdre en productivité
Autre constat troublant : l’IA promet un substantiel gain d’efficacité au travail comme à l’école, or pour le moment, les élèves en perdent à tenter de reformuler pour masquer la triche… que les professeurs se cassent la tête à déceler et à déjouer. Mais qu’en sera-t-il dans quelques années ? A l’aube d’une révolution technologique et sociétale, à l’heure où Laurent Alexandre promeut un livre au titre provocateur (« Ne faîtes plus d’études »), ne doit-on pas se poser en termes complètement nouveaux la question du temps des jeunes de demain ?