Canguilhem, résistant de la Truyère : c’est en 1995 que ce brillant médecin et philosophe qui s’est illustré dans la Résistance cantalienne, a disparu. Trente ans donc cette année. Avec les commémorations de l’armistice, il serait opportun de sortir son nom des bibliothèques spécialisées pour lui rendre sa juste place : celle d’un grand Homme aux convictions admirables, au parcours inspirant. « Canguilhem, c’est un homme », dira de lui Michel Serres1. Voyons cela.
L’enfant de Castelnaudary

C’est à Castelnaudary, dans l’Aude, en 1904, que naît Georges Canguilhem. Son père y est tailleur tandis que la famille de sa mère s’est émancipée de la paysannerie en administrant des terres agricoles.
Le jeune George manifeste très tôt des dispositions pour les études. En 1921, c’est avec un an d’avance qu’il obtient son baccalauréat au lycée de sa ville. Poussé par un professeur, il refuse la bourse d’étude qui l’aurait amené à Montpellier pour intégrer les classes préparatoires du lycée Henri-IV à Paris.L’enfant du Sud-Ouest semble destiné à inscrire le nom de sa famille en haut des frontons des plus grandes institutions : il ne démentira pas ce destin. En 1924, à tout juste vingt ans, le jeune homme intègre l’École Nationale Supérieure, dans la promotion de Jean-Paul Sartre et de Raymond Aron. Il s’intéresse alors à une discipline nouvelle, la sociologie… un engagement des plus hétérodoxes à l’époque où ce champ d’étude était considéré comme anti-intellectuel. Trois ans plus tard, en 1927, ayant déjà affirmé de puissantes convictions pacifistes, il obtient brillamment l’agrégation de philosophie, devant Jean Cavaillès, son futur collègue et compagnon de Résistance.
En 1929, après son service militaire, le jeune professeur prend ses fonctions au lycée de Charleville. C’est la déception. Il écrit à son ami Jean-Richard Bloch :
Que fais-je ici dans ce lycée léthargique ? Vieux profs que l’âge et la première classe consolent de n’avoir que la moitié de ce qu’il faudrait être pour être digne non d’enseigner mais d’apprendre à enseigner. Ils regardent si mon ventre pousse, car cela les rassurerait. Un seul attachement sacré, les élèves, pourtant bien nuls et bien somnolents 2
En1930, son affectation au lycée d’Albi ne le réjouit pas davantage. Il écrit au même ami :
J’ai comme collègues des maniaques dont un a la manie de la persécution, un proviseur papelard, un économe amnésique. C’est ce qu’on appelle un personnel d’élite dans les discours officiels.
Cette carrière naissante ne le comblant pas, un an plus tard, Georges qui s’est marié avec Simone Anthériou, l’une de ses collègues, sollicite une mise en disponibilité : aux commandes de la revue Libres propos, il réaffirme les positions antimilitaristes et anarchistes qui furent celles de son maître Alain, convictions dont il se départira progressivement. En effet, ayant réintégré l’enseignement dès 1932 – à Douai puis à Valenciennes – George, le futur résistant de la Truyère, a fini par obtenir une classe de khâgne au lycée Fermat de Toulouse en 1936.
Il fréquente alors ceux qui constitueront bientôt les premiers cercles de résistance et forge, auprès de ses amis Camille Planet – ami d’enfance également professeur de philosophie – et Tentrin, un libraire toulousain, une éthique de l’engagement3. Par ailleurs, le jeune enseignant sévère et intransigeant, insatisfait de son état, entame une courageuse reconversion dans des études médicales.
Avant la Truyère, résistant dans le Sud-Ouest
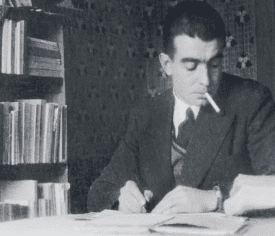
Ce n’est qu’en 1940 qu’il présente sa démission – décision emportée par ses convictions : impossible pour lui de devenir le complice de Vichy dont l’enseignement se fait le relai. Il se rapproche de la Dernière Colonne, une organisation clandestine implantée dans la région toulousaine qui entend manifester son opposition à la trahison de Pétain par la distribution de tracts. L’université de Strasbourg ayant pris ses quartiers à Clermont-Ferrand, en zone libre, Jean Cavaillès, le compagnon des études d’agrégation devenu maître de conférence, a vaillamment commencé à réunir autour de lui quelques hommes de bonne volonté. Cette Dernière colonne est le noyau dur du mouvement de Résistance Libération-Sud, dont le bulletin de liaison, Libération, sera diffusé à partir de 1941 grâce à l’héroïque journaliste du quotidien La Montagne, Jean Rochon. Cette même année 1941 voit le retour de Cavaillès à Paris : c’est Georges qui le remplace à la direction du journal Libération et sur son poste à l’université de Strasbourg repliée à Clermont. Le voici donc Résistant sous le pseudonyme de « Lafont ».
En novembre 1942, c’est l’invasion de la zone sud… et le début de la traque pour l’université, qui accueille alors environ cinq cents Alsaciens, des « Allemands de souche » que les Nazis souhaitent rapatrier. Pour la ville de Clermont et la communauté universitaire à laquelle appartient Georges, les événements se précipitent. Il nous faut donc quitter le professeur Canguilhem quelques instants afin de suivre la sombre histoire qui s’écrit autour de lui.
Les événements de Clermont-Ferrand

Le 24 juin 1943, un professeur résistant exécute deux membres de la Gestapo dans sa propre maison : en représailles, une première rafle est menée à l’université dans la nuit du 24 au 25, suite à laquelle trente-sept juifs seront déportés. Mais le pire est à venir.
Quelques mois après, le 25 novembre, une nouvelle rafle est organisée au sein des milieux universitaires. Entre dix heures et dix heures trente, tandis que des professeurs sont arrêtés à leur domicile, que la Bibliothèque Nationale Universitaire du boulevard Lafayette et les bâtiments Vercingétorix sont assiégés, ceux de la faculté de Lettres sont encerclés par deux cents Nazis. L’un d’eux croise sur le trottoir Louis Blanchet, un lycéen de quinze ans en chemin vers son pensionnat de Godefroy de Bouillon : il lui intime l’ordre de lui faire place… Louis semble se moquer. Il est immédiatement abattu d’une salve de six balles de mitraillette. Devant la faculté de droit, également assaillie, un jeune homme assis sur un banc est blessé puis achevé.
Onze heures. Le cours est terminé. Professeurs et étudiants sont cueillis aux portes des salles, réunis dans la cour de la faculté, braqués par les soldats postés aux fenêtres. Le professeur Paul Collomp, qui a le malheur de ne pas lever les bras assez vite, est exécuté sommairement. Deux groupes sont formés : Clermontois et Strasbourgeois. Les premiers sont libérés.
Quinze heures. L’étau se resserre sur les quelques cinq cents Alsaciens captifs. Le groupe est réuni dans un grand réfectoire. Impossible désormais de s’échapper : c’est sous étroite surveillance que les femmes, puis les hommes, sont autorisés à soulager leurs besoins personnels.
Vingt-deux heures. Après sept heures de captivité, des soldats français viennent se saisir des hommes pour les conduire à deux jeunes gens qui vont sceller leur destin.
Le premier, Georges Mathieu, est étudiant en Lettres : d’abord résistant, il œuvre désormais auprès du Sonderkommando de Clermont. La seconde, Ursula Brandt, surnommée « la panthère », est une étudiante allemande de l’université de Strasbourg, secrétaire et traductrice du SIPO-SD (l’organisation SS) de Clermont. Les prisonniers se voient d’abord dûment contrôlés par la police puis interrogés et triés par Mathieu. A quatre heures du matin, un groupe est relâché mais cent trente hommes et femmes, juifs, résistants ou étrangers restent prisonniers.
Ils seront déportés.
Les jours suivants, des Clermontois défilent devant l’université en chantant la Marseillaise. Quant à Mathieu, l’étudiant transfuge, le fossoyeur de l’univserité de Strasbourg, il sera arrêté puis fusillé le 12 décembre 1944.
Le médecin engagé
Georges Canguilhem, qui a échappé à la rafle, ne retourne pas à l’université. Démissionnaire et sans poste, il poursuit ses études de médecine, soutenu par sa femme : Simone est toujours enseignante et subvient aux besoins de la famille qui compte désormais trois enfants. C’est enfin le 12 juillet 1943, à l’âge de trente-neuf ans et au cœur des événements tragiques de l’université de Strasbourg à Clermont, qu’il soutient sa thèse de médecine, intitulée Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique. Cet ouvrage, qui fit date, sera réédité en 1966 sous le titre Le Normal et le Pathologique. Notre futur résistant de la Truyère y interroge ce qu’on nomme « maladie » et « santé », propose de voir dans la première non plus une négation de la seconde, une anormalité, mais une nouvelle dimension du vivant.
Au cours de cette année 1943, le réseau Libération-Sud rejoint les MUR, Mouvements Unis de la Résistance. Son représentant, l’héroïque journaliste auvergnat Jean Rochon, s’est réfugié à Paulhaguet : Canguilhem le remplace et participe à la mise en place de la lutte armée dans le Cantal. Sur le secteur peu opportunément choisi de la Truyère, il va déployer son énergie de médecin engagé, organisant un service de santé destiné aux maquisards auquel contribue, outre de jeunes volontaires, le médecin sanflorain Louis Mallet. A Maurines, village tout proche de Chaudes-Aigues surplombant la vallée du Bès, le médecin résistant de la Truyère installe au début de l’année 1944 une infirmerie clandestine.
Revenant sur les événements qui allaient suivre dans son texte « Gévaudan 44 », largement dédié à la mémoire de ses éminents collègues strasbourgeois, il écrira :
J’ignore quelles raisons de stratégie ou peut-être simplement de commodité avaient fait choisir ce point dont la vulnérabilité sauta à mes yeux, pourtant peu militaires, quand je rejoignis à mon tour le réduit. En fait, on était là près de Saint-Flour, important nœud de routes où l’on débouche du Midi vers les plaines du Centre, petite ville sans occupants où la Résistance vivait presque aussi libre que chez elle jusqu’environ ce mois de mai, donc lieu d’élection pour une expérience de libération d’un territoire français qui ne dût son salut qu’à lui-même.
Le Mont-Mouchet
La Libération se prépare. Dans les monts de la Margeride, les Forces Françaises de l’Intérieur se rassemblent, des volontaires convergent, qui s’organisent en quinze compagnies. Au mois de mai, en vue d’une mobilisation générale, Canguilhem réunit autour de lui les nombreux représentants de la résistance locale dont, pour le Cantal, Jean Lépine et Pierre Couthon, et fait adopter une réorganisation du réseau. La Direction des Opérations Spéciales, service britannique créé en juillet 40 par Churchill afin de soutenir les mouvements de Résistance d’Europe, parachute fusils, fusils-mitrailleurs, mitraillettes et bazookas, ainsi que grenades, munitions et explosifs. Le 10 juin, Canguilhem participe à la bataille du Mont-Mouchet en tant que médecin, aux côtés de Paul Reiss. Ce compagnon de la première heure, professeur agrégé à l’Université de Strasbourg, n’avait pas hésité à s’engager dans le maquis cantalien : depuis le 17 mai, il était lui-même au Mont-Mouchet en qualité de médecin-chef des FFI.
L’opération du Mont-Mouchet est désastreuse : l’Ostlegion allemande pilonne les partisans. Une centaine de morts est à déplorer. Canguilhem organise en urgence le repli dans l’hôpital de Lavoûte-Chilhac et vers son infirmerie de Maurines. La soixantaine de blessés doit parcourir les quarante kilomètres de sentiers montagneux qui séparent le Mont-Mouchet de Maurines poursuivie par la brigade allemande Jesser, tandis que les combats se poursuivent autour d’elle, dans la vallée de la Truyère.
La tragédie de la Truyère
Le 20 juin, l’artillerie, les chars et l’aviation allemands passent à l’attaque à Maurines : en fin de soirée, l’infirmerie doit être évacuée. Les maquisards s’engagent alors de nuit dans la vallée encaissée du Bès, parcourent des kilomètres de sentiers rocheux à flanc de montagne. Parvenus à la rivière, c’est à dos d’hommes, sur la petite passerelle de l’usine sidérurgique qu’ils parviennent à traverser. Le 21, après avoir gravi l’autre versant des gorges, l’infirmerie de fortune s’installe au village d’Albaret-le-Comtal. Canguilhem, Paul Reiss, autre illustre résistant de la Truyère et le curé soignent alors en urgence, procèdent à une amputation puis les blessés sont évacués vers l’est en deux convois sur les chars à bœufs du village : tandis qu’un premier avance à bonne allure, Canguilhem, Paul Reiss et le couple de pharmaciens clermontois Anne-Marie et Max Menut accompagnent les plus gravement blessés à l’arrière. Ce petit groupe est au village de Saint-Just, à huit kilomètres d’Albaret, quand il est dénoncé par un habitant de Saint-Chély. Encerclés, tous les invalides sont immédiatement exécutés ainsi que Paul et le père d’Anne-Marie, qui est capturée. Elle sera déportée. Canguilhem écrira encore :
Reiss est mort face à l’ennemi. Depuis le matin, il savait que la journée serait décisive pour lui comme pour ses compagnons. Depuis quelques heures, il sentait, comme tous, que la route numéro 9 franchie, la sécurité commençait. Reiss est mort aux portes de la liberté, comme est mort aux portes de la résurrection le jeune blessé sauvé par l’amputation de la veille et que les Allemands achevèrent, ainsi que six autres, d’une balle dans la nuque à même les charrettes qui les transportaient. […] La mort au maquis du Docteur Raymond, mort consentie, qui couche cet Alsacien dans la terre du Cantal, et ce savant parmi les laboureurs, est pour ceux qui lui survivent une leçon de foi patriotique, d’unité sociale, et de courage humain.4
Lui est parvenu à fuir dans les bois, quelques mètres en arrière du convoi. C’est caché dans le ruisseau d’Arcomie qu’il assiste au massacre.
Bien que conscient du caractère aventureux de l’opération du Mont-Mouchet, qui déboucha sur un drame, il la défendra dans « Gévaudan 44 » :
[…] cette intention de rendre tous seuls à la France et à la République une partie de territoire, fût-elle de l’étendue d’un arrondissement, même si elle fut l’une des raisons de quelques fautes incontestables dans la manœuvre, ne saurait être tenue simplement pour une puérilité ou pour une forfanterie. L’événement ne doit pas discréditer l’intention.
Médecin à Saint-Alban
Après le massacre de Saint-Just, le résistant de la Truyère rejoint le premier convoi, en prend la tête jusqu’à Saint-Alban et l’installe dans l’hôpital psychiatrique dirigé par le docteur Lucien Bonnafé. Le temps de ce séjour, ses blessés côtoient les aliénés mais aussi nombre d’artistes et de résistants qui y ont trouvé refuge. Il semble plus résilient que jamais, s’enthousiasmant pour la psychiatrie lacanienne que vient présenter et défendre le professeur François Tosquelles. Le séjour est toutefois de courte durée : il est envoyé en mission secrète à Vichy afin de reprendre le contrôle de la ville, libérée le 26 août.
Le 12 septembre, Canguilhem reçoit la Croix de Guerre des mains d’André Diethelm, ministre de la guerre du gouvernement de Gaulle. A cette occasion, une attestation délivrée par Henry Ingrand, Commissaire de la République pour la région de Clermont-Ferrand, mentionne :
[Canguilhem] a montré dans les combats de la Margeride et de Chaudesaigues un courage et une abnégation totale en allant soigner les blessés et les récupérer dans les lignes allemandes. S’est présenté spontanément pour accomplir une mission dangereuse quoique sachant qu’il allait à peu près à coup sûr dans un secteur d’où il ne reviendrait pas. A ajouté : « il faut que quelqu’un y aille, donc j’y vais.
La vie après la guerre : la consécration institutionnelle

Après la guerre, le parcours intellectuel de Georges Canguilhem est justement honoré. Il succède à Cavaillès, autre victime des Nazis, comme maître de conférence à l’université de Strasbourg. Il est nommé Inspecteur Général de l’Instruction Publique : le professeur exigeant dont le parcours institutionnel a pu sembler bien erratique devint un inspecteur particulièrement redouté par les enseignants.
En 1955, à l’âge de cinquante-et-un ans, il soutient sa thèse de doctorat de philosophie, intitulée La formation du concept de réflexe aux XVIIe et XVIIIe siècles. Succédant à Gaston Bachelard, il prend enfin la tête de l’Institut d’Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques.
Dans les mêmes années, il se prononce pour l’indépendance de l’Algérie puis en mai 68, « la Sorbonne occupée, contrairement à nombre de ses collègues, il ne se retira pas sur ses terres en attendant des jours meilleurs. Il assista silencieux, d’abord amusé puis de plus en plus exaspéré, au grand carnaval des AG »5. Retraité en 1971, celui qu’on surnomme « le Cang » maintiendra une activité intellectuelle intense.
Un homme pour aujourd’hui
Trente ans après sa mort, à l’heure d’une montée des périls où la question de l’engagement, qu’on croyait heureusement évacuée, se pose avec acuité, sa pensée, son œuvre et son actions sont des plus précieuses. Gageons que le Cang, notre médecin de la Truyère, nous sera un exemple.

1Claude Debru, « Georges Canguilhem, acteur et témoin dans l’histoire », Les Cahiers philosophiques de Strasbourg [En ligne], 56 | 2024, mis en ligne le 12 décembre 2024, consulté le 01 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/cps/8270 ; DOI : https://doi.org/10.4000/12tr0
2Extrait de la correspondance de Canguilhem, omecaphes.com
3G. Canguilhem, C. Planet, Traité de logique et de morale, libraire Tentrin, 1939
4G. Canguilhem, «Le professeur Reiss »
5Extrait d’un témoignage cité sur omecaphes.com
Pour en savoir plus sur ce grand homme, philosophe, médecin d’exception et résistant de la Truyère, une belle émission radiophonique ici ! Et pour découvrir d’autres articles sur le Cantal, rendez-vous sur la page de mon blog.

